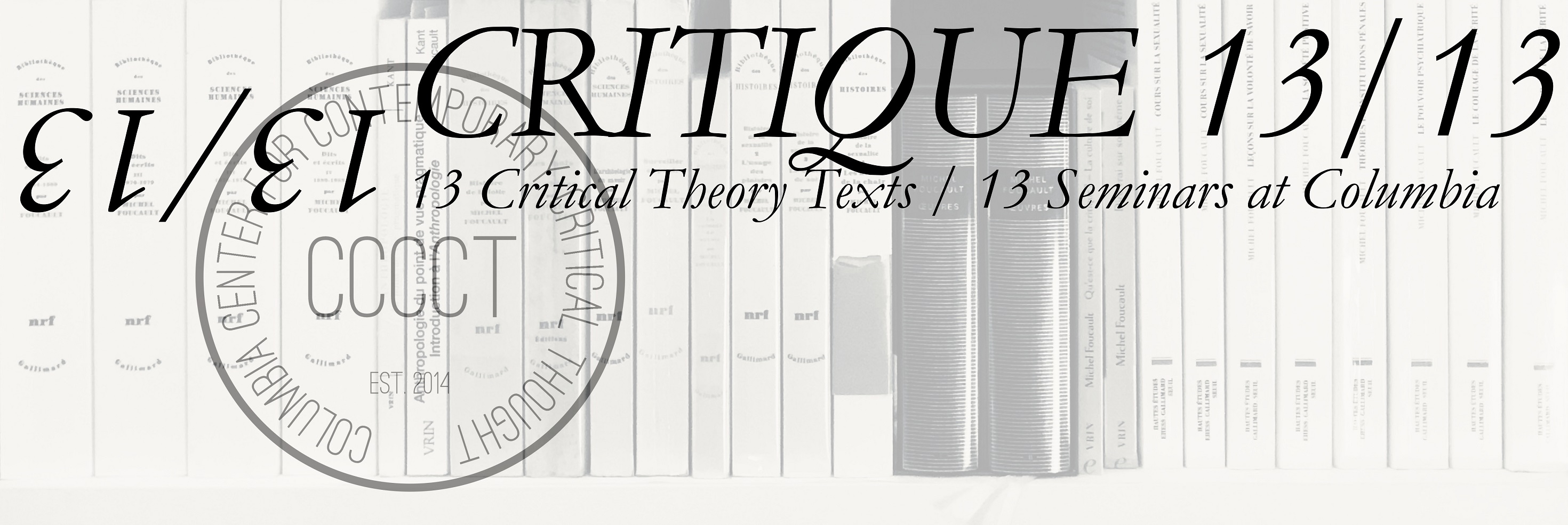Par Judith Revel
Il est difficile de se poser la question de la postérité d’un texte aussi ancré dans les débats de son propre temps que Le deuxième sexe de Beauvoir. Soixante-dix ans, voilà ce qui nous sépare de ces mille pages. Méthodologiquement, il y avait donc deux possibilités.
La première consistait à mesurer la distance qui s’est creusée entre un livre très évidemment fondateur pour le féminisme de la deuxième vague, d’une part, et notre propre situation historique et politique, de l’autre. Nous qui venons après– et si vous me permettez la note biographique : moi qui ai eu vingt ans l’année de la mort de Beauvoir, en 1986 -, nous qui avons en tête les reformulations nécessaires du féminisme de la troisième vague, les revendications de reconnaissance de femmes non-blanches, non-bourgeoises, et non occidentales, qui avons appris à reconnaître l’entrecroisement des disqualifications, des subalternisations, des logiques d’effacement à la fois différentes et combinées qui ont amené ce substantif générique « les femmes » à être décliné de manière infiniment plus complexe (femmes non blanches, femmes prolétaires, femmes précaires, femmes stigmatisées en raison de leur sexualité, de leur religion, de leur âge, de leur corps), nous mesurons la distance d’avec le livre de 1949. Une distance abyssale, d’un certain point de vue : celle qui nous sépare d’un texte qui, d’emblée, place sa réflexion sous la question de l’altérité de « la femme » (la femme : on remarquera en passant l’usage du singulier, très présent dans le texte).
La seconde consistait au contraire à se souvenir d’un très beau petit film réalisé par la comédienne et militante féministe Delphine Seyrig en 1987, « Pour mémoire », qui est montré en ce moment dans le cadre d’une extraordinaire exposition, au Museo Nacional Reina Sofia, à Madrid, consacrée à Delphine Seyrig et à son militantisme féministe, c’est-à-dire aussi aux usages féministes militants de la vidéo à partir des années 1970 ; et qu’on peut voir également au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, que Delphine Seyrig, Carole Roussopoulos et Ioana Wieder avaient fondé en 1982. Delphine Seyrig revient au cimetière Montparnasse un an après l’enterrement de Beauvoir et trouve la tombe débordante de fleurs. C’est pour elle l’occasion d’entrecroiser par conséquent d’une part des images d’avril 1987, des petits mots dans toutes les langues qui ont été déposés, pour ce premier anniversaire, sur la tombe au milieu des fleurs, et, de l’autre, des images de l’enterrement de Beauvoir un an plus tôt – la marche d’hommage du 19 avril 1986, les centaines de banderoles et de rubans venant de tous les coins du monde, l’inimaginable variété des femmes – peut-être faudrait-il dire aussi : des luttes de femmes et du militantisme féministe – qui composent le cortège qui accompagne Beauvoir au cimetière Montparnasse. Il y a là plus qu’un témoignage émouvant : il y a quelque chose qui dit à sa manière l’importance de Beauvoir pour le féminisme contemporain bien longtemps après que Le deuxième sexe a été publié.
Bien sûr, on pourrait se demander si le féminisme de Beauvoir se résume au Deuxième sexe ; et à l’inverse, si la génération qui fut celle du MLF dans les années 1970 – génération que vingt ou trente ans séparaient de Beauvoir et dont les expériences politiques de formation avaient été si différentes (la guerre du Vietnam, 1968…) – devait tant que cela à l’illustre « Momonne ». Dans un extrait d’intervention en anglais, que l’on entend dans le petit film de Seyrig, Beauvoir dit elle-même qu’elle n’a « commencé à devenir beaucoup plus active qu’une fois qu’elle a rencontré le MLF », ce qui posticipe son militantisme féministe de près de 25 ans par rapport à la publication du Deuxième sexe.
Je ne referai pas, faute de temps et de compétence, l’histoire du livre ; ni celle, plus large encore, du féminisme de Beauvoir – cela a été excellemment fait ces dernières années, et la bibliographie ne manque pas. Je voudrais simplement tenter de creuser cette tension – une tension qui ne dit pas qu’un livre est bon ou mauvais, ou qu’il est vrai ou faux, mais qu’il est soumis, parfois, à l’usure du temps, qu’il témoigne à sa manière d’un changement du monde qu’il ne peut totalement accompagner ; mais que sur d’autres points, il a anticipé de manière formidable ce qui devait encore émerger.
Je procéderai par points et je m’en excuse.
1. Derrière « la femme » : les femmes.
Il faut avant toute chose souligner la variété des discours que le livre offre : une véritable palette dans laquelle chacune pouvait se reconnaître, et qui a sans doute fait beaucoup pour son succès. Beauvoir déploie, en particulier dans la seconde partie du livre, toute une série d’analyses reposant sur des figures – la jeune fille, la lesbienne, la célibataire, la femme mariée, la mère… – dont il faut dire l’économie générale, c’est-à-dire aussi le système de représentations et de constrictions, de discriminations et de préjugés qui y est associé. La forme presque encyclopédique de l’ouvrage – utiliser la presque totalité du savoir pour produire une critique de ce même savoir – est à coup sûr l’une de ses forces, puisqu’il permet cette reconnaissance « fine » de la réalité : elle porte aussi avec soi l’idée que, derrière la femme, ou derrière les femmes, ou derrière la catégorie – trois expressions par ailleurs utilisées par Beauvoir -, il y a une pluralité de systèmes d’oppression, de préjugés, de biais représentatifs, qui investissent les différents champs dans lesquels telle ou telle femme peut se trouver située, aussi bien pendant les années de formation que lorsqu’elle rentre dans ce qui semble être le passage inéluctable de toute vie féminine – l’institution du mariage -, ou dans la routine du quotidien, les nécessités de la « parure », les attentes sociales.
Ce déploiement d’approches fines, qui tend à dé-substantialiser le sujet collectif « la femme », est encore renforcé par la part délibérément réduite accordée à des déterminations autres que purement situationnelles, institutionnelles ou culturelles (c’est-à-dire historiques et sociales – ce qui ne minore en rien leur violence) : on se souvient des pages que Beauvoir consacre dans le premier volume à la détermination physique et psycho-physiologique des femmes dans la partie portant pour titre « Destin » – mais c’est une partie qui s’achève par un chapitre, « Le point de vue du matérialisme historique », où elle met immédiatement à distance ce qui a précédé – et par quoi il fallait bien sûr nécessairement passer. J’en cite ici les toutes premières lignes : « L’humanité n’est pas une espèce animale : c’est une réalité historique. La société humaine est une anti-physis : elle ne subit pas passivement la présence de la nature, elle la reprend à son compte. Cette reprise n’est pas une opération intérieure et subjective : elle s’effectue objectivement dans la praxis. Ainsi la femme ne saurait être considérée simplement comme un organisme sexué : parmi les données biologiques, seules ont une importance celles qui prennent dans l’action une valeur concrète ; la conscience que la femme prend d’elle-même n’est pas définie par sa seule sexualité : elle reflète une situation qui dépend de la structure économique de la société, structure qui traduit le degré de l’évolution technique auquel est parvenue l’humanité »[1]. Que le vocabulaire dans lequel s’exprime cet anti-physicalisme radical puisse nous sembler daté ne doit pas nous empêcher de percevoir l’importance du propos : si, comme Beauvoir le dit au début de la seconde grande partie du livre, « Ce monde a toujours appartenu aux mâles »[2], c’est à la fois à la nécessité d’un diagnostic historique, économique et social posé sur la situation des femmes, et à la possibilité d’une réversibilité de cette situation, qu’il s’agit d’arriver. Le « fond commun sur lequel s’enlève toute existence féminine singulière »[3], c’est le monde tel qu’il est « dans l’état actuel de l’éducation et des mœurs »[4].
2. Un matérialisme politique, un constructivisme historique.
La phrase la plus célèbre du livre, « On ne naît pas femme : on le devient », doit être prise au sérieux en ce qu’elle engage, dans les termes mêmes de Beauvoir, une rupture avec toute idée de destin « biologique, psychique, économique »[5]. Dès lors, c’est une analyse de la dynamique de constitution de la femme assignée aux tâches et aux limites qui sont les siennes qu’il s’agit de produire. La longue partie intitulée « Formation » – de la naissance à l’entrée dans l’âge adulte – porte en elle-même la marque d’un décalage qui est précisément dû aux soixante-dix ans qui nous séparent de 1949 : l’effet vintage est évident, même si les pages consacrées par exemple à l’institution de la famille, ou à la sexualité, demeurent d’une actualité étonnante. Parfois, l’effet d’anticipation est impressionnant : les passages consacrés à la maternité, et le devancement d’une revendication de contrôle sur son propre corps en tant que reproductif formule dès 1949 l’esquisse d’une exigence du droit à la contraception et à l’avortement[6].
Parfois au contraire, le raisonnement a terriblement vieilli, non pas par sa faute mais parce que c’est le monde qui a changé. Je n’en prendrai qu’un exemple, mais il est de taille.
3. Travail productif, travail reproductif, I.
Tout le livre – il faudrait bien plus de temps pour le montrer, je me borne donc ici à l’affirmer – est placé sous le signe d’une sorte de relecture marxisée du chapitre IV de la Phénoménologie de l’Esprit de Hegel : si l’homme risque sa vie en s’éloignant de l’animalité, la femme donne au contraire la vie et demeure engluée dans la naturalité. Un exemple parmi de très nombreuses occurrences :
« Certains passages de la dialectique par laquelle Hegel définit le rapport du maître et de l’esclave s’appliqueraient bien mieux au rapport de l’homme à la femme. Le privilège du Maître, dit-il, vient de ce qu’il affirme l’Esprit contre la Vie, par le fait de risquer sa vie : mais en fait l’esclave vaincu a connu ce même risque ; tandis que la femme est originellement un existant qui donne la Vie et ne risque pas sa vie ; entre le mâle et elle il n’y a jamais eu de combat ; la définition de Hegel s’applique singulièrement à elle. (…) La femelle est plus que le mâle en proie à l’espèce ; l’humanité a toujours cherché à s’évader de sa destinée spécifique ; par l’invention de l’outil, l’entretien de la vie est devenu pour l’homme activité et projet tandis que dans la maternité la femme demeurait rivée à son corps, comme l’animal »[7].
En poursuivant l’analogie avec le texte hégélien, l’homme est aussi celui qui, parce qu’il s’est acquis la position du maître, ne fait que consommer sans fin le monde ; alors que l’esclave – la femme -, ayant choisi de ne pas risquer sa vie et demeurant pris(e) à ce titre dans l’animalité que le maître a niée, découvre malgré tout une autre manière de mettre à distance cette dernière. On sait que le raisonnement hégélien accorde au travail une fonction d’émancipation paradoxale parce que l’activité transformatrice du monde est aussi transformatrice de l’esclave lui-même. Toute la question politique de l’émancipation des femmes va donc être de constituer historiquement les conditions de cette transformation : « C’est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui la séparait du mâle ; c’est le travail qui peut, seul, lui garantir une liberté concrète »[8] écrit alors Beauvoir.
Mais c’est sur l’analyse du travail que le texte a le plus vieilli – sans doute parce que la conception que Beauvoir en avait en 1949 est difficilement exportable dans le monde de ce début du XXIe siècle qui est le nôtre. Cette analyse comporte de nombreux points, et je me borne à en souligner deux, qui me semblent particulièrement importants.
Le premier, c’est que s’il s’agit d’œuvrer aux conditions de transformation de la femme dans la praxis, et si cette émancipation passe nécessairement par le travail, alors la lutte des femmes est interne à la lutte plus générale des prolétaires. Patriarcat, capitalisme : il y a là une articulation fondamentale sur laquelle je vais revenir, et Beauvoir a le mérite de l’avoir vue. Mais articulation ne veut pas nécessairement dire dissolution, ou absorption.
On a parfois reproché à Beauvoir une perspective strictement individualiste – une perception du texte sans doute nourrie par l’abondance de voix singulières qu’elle cite et dont elle fait trésor et qui constituent véritablement la trame du livre et sa richesse. Le reproche est injuste : la conscience de ce qu’il s’agit de parvenir à un front de lutte et d’émancipation collectif est pourtant clair : « Le mal ne vient pas d’une perversité individuelle – et la mauvaise foi commence, lorsque chacun s’en prend à l’autre -, il vient d’une situation contre laquelle toute conduite singulière est impuissante »[9]. Mais le modèle de résolution de la contradiction est bien avant tout celui d’une égalité sociale, qui contiendrait en son sein l’égalité homme-femme : « Un monde où les hommes et les femmes seraient égaux est facile à imaginer car c’est exactement celui qu’avait promis la révolution soviétique : les femmes élevées et formées exactement comme les hommes travailleraient dans les mêmes conditions et pour les mêmes salaires »[10]. Bien plus tard, en 1972, dans une interview accordée au Nouvel Observateur, Beauvoir allait revenir sur la question et déclarer : « « Tout ce que je peux constater, et qui m’a amenée à modifier mes positions du Deuxième sexe, c’est que la lutte des classes proprement dite n’émancipe pas les femmes ». Mais elle continuait à souligner l’union nécessaire des luttes : « Moi, ma tendance est de vouloir lier l’émancipation féminine à la lutte de classes. J’estime que le combat des femmes, tout en étant singulier, est lié à celui qu’elles doivent mener avec les hommes. Par conséquent, je refuse complètement la répudiation totale de l’homme »[11].
J’ouvre ici une brève parenthèse.
Sur la position de Beauvoir au moment de la publication du Deuxième sexe, on ne peut pas ne pas faire le parallélisme avec les propos de Sartre sur la question de la race au moment de la publication – en 1948, un an auparavant – de « Orphée noir », la préface qu’il avait rédigée pour l’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de Léopold Sédar Senghor. Voilà ce qu’écrit alors Sartre : « En fait, la négritude apparaît comme le temps faible d’une progression dialectique : l’affirmation théorique et pratique de la suprématie du Blanc est la thèse ; la position de la négritude comme valeur antithétique est le moment de la négativité. Mais ce moment négatif n’a pas de suffisance par lui-même et les Noirs qui en usent le savent fort bien ; ils savent qu’il vise à préparer la synthèse ou réalisation de l’humain dans une société sans races. Ainsi la Négritude est pour se détruire, elle est passage et non aboutissement, moyen et non fin dernière »[12]. Rappelons au passage le commentaire sans appel de Frantz Fanon dans Peau noire, masques blancs : « Quand je lus cette page, je sentis qu’on me volait ma dernière chance »[13].
En même temps, le parallélisme n’est peut-être pas si fondé que cela, et il faut sans doute être juste avec Beauvoir : on sent, malgré tout, chez elle, un souci de ne pas perdre en route la singularité du combat des femmes – une singularité qu’il faut arriver à conjuguer avec une idée de l’émancipation qui demeure une catégorie universelle. Mais la tension est bien là, et elle est permanente, parce que, elle le reconnaît elle-même, « la majorité des travailleurs aujourd’hui sont des exploités »[14], et que le travail n’est pas la liberté.
Second point, toujours à propos du travail. Si le travail, en tant qu’activité transformatrice de soi et du monde, est un vecteur d’émancipation, il est essentiel d’en dire la définition et le périmètre. Le travail productif est, dans les analyses du Deuxième sexe, systématiquement opposé au travail reproductif, dont il s’agit au contraire de sortir. D’un côté, le « vrai » travail ; de l’autre, toute cette série d’activités domestiques invisibles et non reconnues, assujettissantes et déqualifiantes, dont il faut se libérer. Beauvoir voit bien que l’activité domestique est paradoxalement la condition de possibilité du travail que l’on considère comme digne de ce nom – « L’homme est relié à la collectivité, en tant que producteur et citoyen, par les liens d’une solidarité organique fondée sur la division du travail ; le couple est une personne sociale, défini par la famille, la classe le milieu ; la race auxquels il appartient », écrit-elle alors[15], en comprenant à quel point le travail reproductif, si on entend par là non seulement la reproduction biologique mais toute contribution à la reproduction de la force de travail, est la condition dissimulée du travail productif – une sorte de condition effacée, un pur moyen au service d’une fin qui n’a de cesse de l’occulter en tant que telle. Beauvoir insiste : « Mais ce qui rend ingrat le rôle de la femme-servante, c’est la division du travail qui la voue tout entière au général et à l’inessentiel ; l’habitat, l’aliment sont utiles à la vie mais ne lui confèrent pas de sens : les buts immédiats de la ménagère ne sont que des moyens, non des fins véritables »[16]. En somme : il y a, dans ce que l’on nomme « travail », un dedans et un dehors du travail, une fin (la production) et un moyen (la reproduction), une visibilité et un effacement, et c’est la forme que prend, du point de vue de l’activité, la division sexuelle des rôles et des tâches.
L’improductivité de l’activité domestique féminine, tout juste esquissée comme condition de la production masculine, sous-entend en réalité deux éléments de raisonnement. Le premier, classiquement emprunté à l’analyse marxienne de la production, ne reconnaît de travail productif que là où il y a production de survaleur – ce qui n’est bien évidemment pas le cas du travail domestique en 1949. Dans cette grille de lecture, le travail domestique est par conséquent foncièrement improductif. C’est parfois ce qui émerge aussi de positions plus tardives de Beauvoir – je pense à cet entretien de 1972 que j’ai déjà cité, « La femme révoltée », où elle dit : « Je trouve que les analyses qui font de l’oppression patriarcale l’équivalent de l’oppression capitaliste ne sont pas justes. Le travail de la ménagère ne produit pas de plus-value : c’est une autre condition que celle de l’ouvrier à qui on vole la plus-value de son travail. Je voudrais savoir exactement quels rapports existent entre les deux. Toute la tactique que doivent suivre les femmes en dépend »[17].
Le second tend à distinguer le travail masculin, producteur de transformations durables de la nature, et ce travail vain, quotidien et répétitif, que rien ne retient à la surface des choses, et qui s’épuise presque immédiatement dans une consommation instantanée, qui est celui des femmes. Le deuxième sexe est écrit neuf ans avant la publication de The Human Condition de Arendt – mais quand Beauvoir écrit : « Le plus triste, c’est que ce travail n’aboutit même pas à une création durable (…). Il faut donc que le produit du travail ménager se consomme ; une constante renonciation est exigée de la femme dont les opérations ne s’achèvent que par leur destruction »[18], ou bien quand elle prend de manière répétée l’exemple du plat tout juste sorti du four et posé triomphalement sur la table – avant qu’il ne soit anéanti par les appétits familiaux -, elle distingue en réalité dans des termes presque arendtiens la production d’une transformation affectant le monde et se survivant à elle-même, qui est la prérogative des hommes, et l’évanescence un peu ridicule des produits du labeur domestique, qui est destiné à disparaître littéralement sans laisser de trace. La pure consommation à laquelle est destiné le pur labeur – le travail au sens arendtien – est ici assigné aux femmes ; quant à l’œuvre, dans les termes de Arendt, elle est tout entier du ressort du travail masculin.
Conclusion de Beauvoir : « Ainsi, le travail que la femme exécute à l’intérieur du foyer ne lui confère pas une autonomie : il n’est pas directement utile à la collectivité, il ne débouche pas sur l’avenir, il ne produit rien »[19].
4. Travail productif, travail reproductif, II.
Il y a bien longtemps que la prise en considération du travail reproductif est entrée de plein droit non seulement dans les revendications féministes mais dans l’analyse économique et sociologique de la production de la valeur. De la saison intense des luttes féministes réclamant un salaire domestique, des « wages for housework », un « salario per il lavoro domestico » – on pense ici aux textes de Mariarosa Dalla Costa et de Selma James – on se souvient peut-être trop peu, même si certaines féministes plus récentes ont repris le fil de ces analyses essentielles – je pense ici par exemple à Silvia Federici. On se souvient trop peu, sans doute, mais force est de reconnaître que le travail reproductif des femmes, si longtemps nié comme travail, est devenu aujourd’hui le barycentre de tout un secteur que l’on désigne parfois comme services à la personne, parfois encore comme « économie du care », et qui est loin d’être extérieur à l’exploitation capitaliste, c’est-à-dire à l’extraction de survaleur. Du travail éducatif au travail du soin, de l’assistance aux personnes dépendantes aux multiples visages de la valorisation affective des prestations productives, le devenir-femme du travail avance, il est au cœur du processus de valorisation du capital actuel, et il représente, au regard des analyses de Beauvoir en 1949, un double paradoxe. C’est avec ce double paradoxe que j’aimerais en terminer.
Premier paradoxe : alors que les femmes ont été historiquement exclues du monde du travail, et que l’un des enjeux de leur émancipation a correspondu avec une lutte pour une sortie des murs domestiques et l’accès au marché du travail, ce même marché du travail présente aujourd’hui de plus en plus, et toujours plus généralement, les caractéristiques de ce que l’on a considéré historiquement comme le non-travail domestique féminin : un temps de labeur confondu avec le temps de la vie tout entière, une invisibilisation de plus en plus grande, une décomposition de plus en plus importante du cadre juridique dans lequel prend place l’activité, et des qualités entièrement basculées du côté de l’affectivité, de la compréhension, de l’émotion, de la patience et de la générosité, de la créativité et de l’attention, de la disponibilité et de la faculté d’adaptation – en somme : des qualités « féminines », ces mêmes qualités que l’on a bien tenté de naturaliser par le passé pour en faire l’essence du substantif générique « la femme », mais qui n’en sont pas moins devenues les qualités que l’on demande aujourd’hui à tous, travailleuses et travailleurs, afin de produire de la valeur.
Deuxième paradoxe : s’il y a bien une intuition à reprendre aujourd’hui au Deuxième sexe, c’est celle dont Beauvoir ne sait pas exactement que faire et autour de laquelle elle ne cessera de tourner jusqu’au années 1970, qui consiste à postuler le lien entre critique du patriarcat et critique du capitalisme. Beauvoir ne sait qu’en faire parce que l’alternative devant laquelle elle se trouve semble se résumer au choix de la contradiction la plus grande, ou à celle de « l’ennemi principal », pour reprendre l’expression de Christine Delphy ; et que, j’ai essayé de le montrer rapidement, le texte de 1949 est tiraillé entre la volonté de préserver une singularité à l’émancipation des femmes et l’idée qu’il faut œuvrer à une universalisation des mouvements d’émancipation en général, dans laquelle le féminisme trouvera bien entendu sa place.
J’ignore si, en 1949, il était possible de penser autrement. Ce que je sais, c’est qu’aujourd’hui, nombreuses sont les féministes pour lesquelles la dénonciation du patriarcat comme système inégalitaire, comme structure sociale assujettissante, comme assignation des femmes à une improductivité supposée (qui va de pair, soit dit en passant, avec une aphasie postulée), passe avant toute chose par un renversement radical de cette « improductivité ». Les femmes ne cessent de produire. La reproduction sociale a été historiquement la condition de possibilité de ce que nous avons appelé pendant deux siècles « production » ; elle se confond aujourd’hui avec la production elle-même, dont le pillage systématique, la spoliation de la valeur, est au cœur du nouvel extractivisme du capital. Extraire de la valeur de nos vies : qui, mieux que les femmes, peut en comprendre les rouages ? Les femmes ont été historiquement soumises à ce saccage avant les hommes : il leur revient de montrer aux hommes comment il fonctionne. Saper les bases du patriarcat, c’est donc contribuer à produire une critique puissante du capitalisme actuel : non pas parce que les femmes seraient une nouvelle avant-garde, qu’elles seraient meilleures que les hommes, ou que leurs qualités en tant que femmes en feraient des sujets politiques meilleurs. Non, rien de tout cela : simplement parce que l’exploitation capitaliste a changé de visage, et fait de ce qui était le « dehors » de la production assigné pendant des siècles aux femmes son cœur le plus intime, et de la relégation des femmes le cadre général d’une exploitation que nous avons désormais, toutes et tous, en partage. « On ne nait pas femmes, on le devient », écrit Beauvoir en 1949. On aurait envie d’ajouter en 2019, au nom de ce devenir-femme du travail et de la production contre quoi il faut se dresser : les hommes ne naissent pas femmes, mais de plus en plus souvent ils le deviennent. A nous de le leur apprendre.
Notes
[1] Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, Paris, Gallimard, 1949, chapitre III : « Le point de vue du matérialisme historique » – réed. coll. « Folio Essais », vol. I, p. 98. C’est moi qui souligne.
[2] Id., ibid., vol. I, Deuxième partie : « Histoire », p. 111.
[3] Id., ibid. vol. II, « Introduction », p. 9.
[5] Id., ibid., vol. II, p. 13.
[6] Voir par exemple vol. II, p. 608 : « Il y a une fonction féminine qu’il est actuellement presque impossible d’assumer en toute liberté, c’est la maternité ; en Angleterre, en Amérique, la femme peut du moins la refuser à son gré grâce aux pratiques du birth-control ; on a vu qu’en France elle est souvent acculée à des avortements pénibles et couteux… »
[7] Id., ibid., vol. I, « Histoire », p. 116-117. C’est Beauvoir qui souligne.
[8] Id., ibid., vol. II, Quatrième partie, « Vers la libération », chapitre XIV : « La femme indépendante », p. 587.
[9] Id., ibid., vol. II, « Conclusion », p. 643.
[10] Id., ibid., vol. II, p. 643.
[11] Simone de Beauvoir, « La femme révoltée », propos recueillis par A. Schwarzer, Le Nouvel Observateur, 14 février 1972, p. 47-54, reproduit dans F. Claude et F. Gonthier, Les écrits de Simone De Beauvoir. La vie, l’écriture, Paris, Gallimard, 1979, p. 482-497.
[12] Jean-Paul Sartre « Orphée noir », Préface à L. S. Senghor, Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache, Paris, PUF, 1948, p. XL et suivantes.
[13] Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil, 1952, réed. coll. « Points Essais », p. 108.
[14] Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, op. cit. vol. II, chapitre XIV : « La femme indépendante », p. 588.
[15] Id., ibid. vol. II, chapitre VII : « La vie en société », p. 387
[16] Id., ibid., vol. II, chapitre V : « La femme mariée », p. 272. C’est Beauvoir qui souligne.
[17] Simone de Beauvoir, « La femme révoltée », op. cit., p.486 et 490-491 .
[18] Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, op. cit.., chap. V, « La femme mariée », p. 274.